Réparation automobile : obligations et étendue de la responsabilité du garagiste
Article juridique publié le 29/04/2015 à 13:43, vu 34009 fois, 49 commentaire(s), Auteur : Yaya MENDY
Quelles sont les obligations du garagiste ? Et comment engager sa responsabilité ?
I. Quelles sont les obligations du garagiste ?
une obligation de résultat:
Le garagiste est tenu à une obligation de résultat (article 1147 du code civil). C’est-à-dire il s’est engagé à faire quelque chose (remettre le véhicule en bon état de fonctionnement). Le seul fait de ne pas arriver à ce résultat constitue une faute permettant d'engager sa responsabilité contractuelle.
Dit autrement, tant que la réparation n’est pas correctement effectuée de façon fiable et durable, il doit la reprendre. A défaut sa responsabilité serait engagée.
En cas de litige, il appartient au garagiste d'apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute dans la réparation ou que la panne vient d'une toute autre cause.
Le réparateur est également responsable des défauts des pièces utilisées. Sa responsabilité peut être engagée en cas de défectuosité des pièces détachées qu’il incorpore dans ses prestations.
Par ailleurs, le garagiste est dépositaire du véhicule durant tout le temps de la réparation. Par conséquent, il est responsable du dommage causé par celui-ci. Il doit aussi veiller à ce que le véhicule qui lui a été confié ne soit ni volé ni détérioré.
A défaut, il sera responsable de la perte partielle ou totale du véhicule (exemple en cas d’incendie ou de vol) à moins qu’il ne démontre que cette perte est le fait de la force majeure ou d’une cause étrangère. Il est également responsable pour la disparition d'objets se trouvant dans le véhicule.
un devoir de conseil:
Le garagiste est aussi tenu à l’égard de son client d’un devoir de conseil et d’information.
En effet, il doit informer et conseiller le client sur l'état de son véhicule, l’opportunité des réparations à effectuer et l'entretien à apporter par la suite.
Il doit notamment renseigner son client sur l’utilité des réparations, lui proposer les solutions les mieux appropriées, l’avertir si les travaux risquent de se révéler prohibitifs ou s’ils se révèlent très supérieurs à la valeur vénale de la voiture ou inutiles vu l’état général de celle-ci. A défaut, il peut engager sa responsabilité.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que le mécanicien qui omet d'aviser le client sur l'intérêt de recourir au remplacement d'un moteur défectueux plutôt qu'à sa réparation d'un coût voisin engage de ce fait sa responsabilité. (Cass. civ 1ère, 15 mai 2001, pourvoi n° 99-14128)
De même, le garagiste qui effectue sur un véhicule des travaux d'un montant très supérieur à la valeur vénale de celui-ci, sans avoir obtenu l'accord préalable du propriétaire commet une faute et est tenu, par conséquent, de réparer le dommage causé à son client. (Cass. civ 1ère, 7 juin 1989, pourvoi n° 87-16937).
Toutefois, si le garagiste constate, en cours d’intervention, la nécessité d’effectuer des travaux supplémentaires n’ayant pas été prévus initialement, il doit avertir son client sur leur nature et attendre son accord avant d’effectuer lesdits travaux. Il ne doit pas prendre l’initiative d’effectuer les travaux supplémentaires sans l’accord du client.
A défaut, les travaux supplémentaires, bien que justifiés, ne pourront pas donner lieu à une facturation de la part du garagiste et le client peut refuser de les payer.
C’est ce qui ressort d’un arrêt de la Cour de cassation qui énonce : « Le garagiste qui a réalisé sur le véhicule de son client des travaux qui ne lui avaient pas été commandés ne peut, en se fondant sur l'enrichissement sans cause, réclamer à celui-ci aucune indemnité » (Cass. civ. 1ère, 24 mai 2005, pourvoi n° 03-13534 ; Cass. civ 1ère, 6 janvier 2004, pourvoi n° 00-16545).
En cas de contestation, il incombe au garagiste d'apporter la preuve que le client a commandé les travaux supplémentaires ou du moins les a accepté, peu importe si ces derniers étaient nécessaires ou non. D’où l’intérêt d’établir une feuille de réparation au moment de la conclusion du contrat.
une obligation de sécurité:
Selon la Cour de cassation, « le garagiste est tenu, envers ses clients qui lui confient un véhicule en réparation, d'une obligation de sécurité dont il peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute » (Cass. civ. 1ère, 9 juin 1993, pourvoi n° 91-17387)
Cette obligation de sécurité oblige le garagiste à avertir formellement son client, lorsqu’il découvre une défectuosité qui met la sécurité des utilisateurs du véhicule en jeu.
Dans ce cas, il doit informer le client du défaut en question en attirant explicitement son attention sur le danger encouru en lui proposant d’effectuer les réparations qui s’impose. Si le client refuse d’effectuer lesdites réparations, le garagiste a intérêt à garder une trace écrite de ce refus (par exemple en le notant sur la feuille de réparation ou la facture) afin de se préconstituer une preuve.
'
En cas de réparation défectueuse, le garagiste sera responsable des dommages causés par sa faute et devra donc indemniser le client et les tiers ayant subi un préjudice en raison de cette mauvaise réparation.
Ainsi, a été condamné à réparer le préjudice subi par son client, le garage qui a mal refermé le bouchon de vidange d'une moto après son intervention causant ainsi un accident. (Cass. civ.1ère, 30 juin 1993, n°91-12830)
Par ailleurs, si le garagiste a mal effectué les réparations et met ainsi son client en danger, il peut être poursuivi sur le plan pénal pour mise en danger de la vie d'autrui, blessure ou homicide involontaire. |
II. Comment engager la responsabilité du garagiste ?
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte une présomption de responsabilité à son égard en cas de dommage constaté suite à son intervention ; c’est-à-dire le garagiste est responsable de plein droit de toutes les pannes survenues après son intervention sans qu'aucune preuve de quelque nature que ce soit n'ait à être rapportée.
En effet, les juges considèrent généralement que tout désordre postérieur à une quelconque réparation rend automatiquement responsable le garagiste en se fondant sur une double présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Cass. civ. 1ère, 20 juin 1995, n° 93-16.381; Cass. civ. 1ère, 8 décembre 1998, n° 94-11.848)
Autrement dit, s’il est avéré que le véhicule n’a pas été restitué en état de marche ou est tombé une nouvelle fois en panne pour les mêmes raisons, le garagiste est présumé responsable au regard de l’obligation de résultat pesant par principe sur le réparateur professionnel.
Par conséquent, le client est dispensé de faire la preuve de la faute du garagiste et du lien causal que celle-ci entretient avec le dommage qu’il a subi.
Il incombe au garagiste de renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en rapportant la preuve que la persistance de la panne ne découlait pas de prestations insuffisantes ou défectueuses de sa part.
Toutefois, le réparateur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant qu'il s'est heurté à une exécution impossible du fait d'une cause étrangère (art. 1147 du code civil) présentant un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur.
Exemple de causes étrangères :
un vice interne du moteur constitué par une usure considérable
ou une faute du client
Le garagiste ne peut non plus se retrancher derrière le mystère de la défaillance du véhicule pour échapper à sa responsabilité. La cause inconnue de la panne n'est jamais en effet assimilable à la cause étrangère. (Cass. com., 6 septembre 2011, pourvoi n° 10-30647)
Néanmoins, toute panne survenant sur un véhicule après l'intervention d'un garagiste réparateur n'est pas toujours susceptible d'engager sa responsabilité.
En effet, la Cour de cassation a jugé que : « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu’il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ». (Cass. civ. 1ère, 31 octobre 2012, pourvoi n°11-24324)
Autrement dit, la présomption de responsabilité qui pèse sur le garagiste se limite aux seuls dommages qui résultent de son intervention. Par exemple, il n’a pas réussi à mettre le véhicule en état de marche ou celui-ci est tombé une nouvelle fois en panne juste après son intervention.
Toutefois, si le dommage subi survient longtemps après la réparation effectuée par le garagiste ou si, entre temps, le véhicule a parcouru un nombre important de kilomètres, c’est alors au client insatisfait d’apporter la preuve que le dommage dont il demande réparation a pour origine l’intervention du garagiste ou du moins existait déjà au jour de son intervention. (Cass. civ.1ère, 28 mars 2008, n° 06-18350)
Pour ce faire, le client devra préalablement démontrer un lien de causalité entre le dommage subi et la réparation effectuée.
Je reste à votre disposition pour toutes questions supplémentaires.
Yaya MENDY
|
La responsabilité professionnelle du réparateur automobile
Une présomption de responsabilité
Les principes généraux qui régissent les obligations du réparateur automobile, dont le fondement légal est posé aux articles 1779 et suivants du Code civil, ont été forgés par la jurisprudence des Tribunaux, caractérisée par une tendance à accentuer au fur et à mesure l’étendue de cette responsabilité et par la volonté d’en faciliter la mise en œuvre.
Il a d’abord été posé le principe que le réparateur est tenu d’une obligation de résultat plutôt que d’une simple obligation de moyens et il est aujourd’hui clairement affirmé par la jurisprudence que cette obligation de résultat emporte une présomption de responsabilité lorsqu’un dommage est constaté à la suite de son intervention, ce qui implique que tant sa faute que le lien de causalité entre celle-ci et le dommage sont présumés.
Au client subissant une avarie à la suite d’une intervention il n’incombe que d’établir le dommage, lequel doit cependant avoir un lien avec l’intervention, et c’est le réparateur qui a la charge, pour s’exonérer, d’établir qu’il n’a pas commis de faute pour avoir suivi les règles de l’art et les préconisations du constructeur ou si une faute est démontrée, que celle-ci est sans lien avec l’avarie survenue, étant précisé que le doute ou l’incertitude ne profite pas au réparateur.
La réparation doit en conséquence être complète et efficace, sauf pour le réparateur à rapporter la preuve de ce que le client a refusé une remise en état complète.
La responsabilité du réparateur s’étend en outre évidemment aux défectuosités pouvant provenir des pièces détachées qu’il incorpore dans ses prestations, sauf lorsqu’elles sont fournies par le client mais dispose en revanche, sauf clause d’exclusion de garantie dans ses rapports avec son fournisseur, d’un recours à l’encontre de ce dernier.
Le réparateur doit donc prendre un soin particulier à la sélection de ses fournisseurs et s’inquiéter de l’origine des pièces acquises pour bannir les fabrications douteuses et, a fortiori, contrefaisantes, sauf à exposer sa responsabilité, laquelle peut en outre être de nature pénale à l’égard des entreprises titulaires de droits de propriété industrielle sur les pièces détachées contrefaites qu’il pourrait détenir dans son stock.
La responsabilité du réparateur a donné lieu à une jurisprudence abondante dont il résulte notamment :
- que si la défaillance d’un organe mécanique rend nécessaire une nouvelle intervention après une première réparation, il appartient alors au garagiste de démontrer que l’usure de la pièce défectueuse n’exigeait pas qu’elle fût remplacée lors de la première intervention,
- que le réparateur ne doit pas se limiter aux seules indications données par le propriétaire du véhicule, qui n’est pas un professionnel, et il doit en conséquence effectuer un diagnostic complet des réparations à accomplir pour permettre son usage normal. Un réparateur a ainsi par exemple été condamné à rembourser le changement complet du moteur d’un véhicule tombé en panne 150 kms après une intervention consistant au changement de sa culasse sur les indications erronées du client qui avait confondu le témoin de pression d’huile et l’indicateur de température d’eau,
- que le client ne saurait être condamné au paiement d’une partie du prix d’une intervention tenant compte “du travail et des prestations effectuées” si le véhicule réparé ne fonctionne pas après l’intervention du réparateur.
Le devoir de conseil
Le réparateur est également tenu d’un devoir de conseil qui lui impose en premier lieu de renseigner son client sur l’opportunité d’une réparation, notamment si elle est incertaine quant à son efficacité, ou encore si son coût est objectivement disproportionné par rapport à l’état ou à la valeur vénale du véhicule.
Il a ainsi été jugé qu’un réparateur avait manqué à son devoir de conseil en omettant d’attirer l’attention de son client sur l’intérêt de recourir au remplacement du moteur plutôt qu’à sa réparation, le coût des travaux étant voisin.
En cas de litige, pour obtenir le règlement des ses prestations, il incombera au réparateur d’établir qu’il a informé son client et il y donc un intérêt évident à en conserver la preuve écrite, par des mentions explicites sur l’ordre de réparation signé par le client.
En outre, c’est l’ordre de réparation qui fixe le périmètre de l’intervention du réparateur et donc celui de la responsabilité qu’il encourt au titre de son devoir de conseil en cas d’avarie postérieure à son intervention.
Il convient également de préciser que les obligations qui sont mises à la charge du réparateur le contraignent, lorsqu’il met au jour une défectuosité qui met la sécurité d’utilisation du véhicule en jeu, à en avertir formellement son client. Si ce dernier refuse de laisser le réparateur entreprendre les travaux nécessaires, ce dernier aura tout intérêt à conserver la preuve de ce qu’il a dûment informé son client des risques encourus.
Dans cette hypothèse, on ne saurait donc trop recommander au réparateur de mentionner le défaut en question sur la facture en attirant explicitement l’attention du client sur le danger encouru et en conservant une copie de la facture signée par lui à titre de preuve de la mise en garde.
Le réparateur ne peut faire plus puisqu’il ne dispose d’aucun droit pour contraindre un client à faire procéder à des réparations, même si ces dernières concernent la sécurité.
Conséquences de la responsabilité
Le réparateur dont la responsabilité est engagée est tenu d’indemniser son client non seulement pour les réparations rendues nécessaires par sa faute mais seulement pour les conséquences directes de sa faute et notamment pour l’immobilisation du véhicule.
La responsabilité des sous-traitants
Le réparateur est responsable à l’égard de son client des éventuelles malfaçons imputables à un sous-traitant, ce qui ne le prive cependant pas de la possibilité d’exercer un recours à l’encontre de ce dernier. La Cour de cassation a posé le principe que le sous-traitant est contractuellement tenu envers le garagiste qui l’a chargé d’un travail d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage : il appartient en conséquence au sous-traitant de démontrer qu’il n’a commis aucune faute et non au réparateur de rapporter la preuve qu’une malfaçon est imputable à son sous-traitant. La responsabilité de ce dernier pourra en outre être étendue à la totalité des conséquences financières engendrées pour le réparateur dans ses rapports avec son client et non simplement limitée à la valeur de la pièce endommagée (coût de la main d’oeuvre pour la dépose et la repose, pièces détachées, immobilisation du véhicule etc…).
La responsabilité en cas de dommages aux véhicules confiés
Le garagiste réparateur s’engage à un double titre, en vertu d’un louage de service et aussi en vertu d’un dépôt, dépôt nécessaire, puisque la machine confiée pour être réparée ne peut l’être que si elle est laissée, pendant le temps nécessaire aux réparations, au garagiste qui en reçoit le dépôt et doit, au moins pendant ce temps, en assurer sous sa responsabilité, avec vigilance, la bonne conservation.
La jurisprudence existante, prononcée à l’occasion de vols survenues soit des véhicules eux-mêmes soit de leur contenu ou encore à l’occasion de sinistres ayant endommagé un véhicule confié est assez sévère pour le réparateur, la force majeure l’exonérant de sa responsabilité étant très rarement retenue.
Il est en conséquence important que l’entreprise dispose de bonnes garanties d’assurance en la matière lui permettant de faire face à l’éventualité de l’indemnisation de la clientèle.
|
Obligations et responsabilité du garagiste
Le garagiste en sa qualité de professionnel est tenu à l'egard de son client à un certain nombres d'obligatios et notamment en ce qui concerne le prix de son intervention .
Le garagiste a égalemment une obligation de conseil; de sécurité et de résultat dès lors qu'il a accepté la réparation d'un véhicule.
A défaut du respect de ses obligations il engage sa responsabilité à l'égard de ses clients.
L'obligation d'information du garagiste
Les entreprises qui pratiquent l'entretien ou la réparation, le contrôle technique, le dépannage ou le remorquage de véhicules doivent afficher à l'entrée de l'établissement ou au lieu de la réception de la clientèle, lisibles de l'extérieur, les taux horaires TTC et les prix des différentes prestations forfaitaires proposées.
Le devis
Le devis n'est pas obligatoire sauf à la demande du client. Son montant engage le réparateur. Le devis peut être payant (ses modalités d'établissement devront être affichées dans les mêmes conditions que les tarifs).
La facture
Dès lors que le prix de la prestation est supérieur ou égal à 15,24 €, TVA comprise, une note doit être délivrée. (Voir fiche facturation du client devis et note)
Elle comporte :
le nom et adresses du garagiste et du client;
la date;
le détail des taux horaires pratiqués et le mode de calcul (référence au temps passé ou au barème de temps);
le prix des pièces détachées qui sont fournies;
pour les prestations forfaitaires, la liste détaillée des opérations comprises dans le forfait ainsi que les pièces et fournitures éventuellement incluses, sans nécessité toutefois de mentionner le prix correspondant à chaque opération, pièce et fourniture;
le kilométrage inscrit au compteur.
Le décompte détaillé est facultatif lorsqu'un devis descriptif et détaillé a été accepté par le client et conforme aux travaux exécutés.
L'étendue de l'intervention du garagiste
L'étendue de l'intervention du garagiste peut être définie par un "ordre de réparation".
C'est un document écrit que le client signe et qui concrétise l'accord entre celui-ci et le réparateur sur l'étendue des travaux à effectuer. Il a valeur de contrat et détermine les obligations réciproques du réparateur et du client.
Ainsi, sans l'accord du client, le garagiste ne peut pas prendre l'initiative de changer une pièce. En cas de contestation, c'est au garagiste d'apporter la preuve que le client a commandé les travaux ou a accepté les travaux supplémentaires, peu importe si les travaux étaient nécessaires ou non.
Toutefois, en vertu de son obligation de sécurité, le garagiste doit informer le client sur le danger qu'il encoure faute de réparation adéquate.
Il est donc préférable de toujours établir un ordre de réparation précis et chiffré, qui n'engage le client que pour le montant qui a été fixé. Une telle précaution préviendra tout risque de litige sur le montant de la facture qui peut avoir de graves conséquences pour le client. En effet, en cas de désaccord avec le garagiste, si le client refuse de payer la facture, le garagiste peut user de son droit de rétention.
La responsabilité du garagiste
Le réparateur est tenu à un devoir de conseil à l'égard de son client, qui consiste à lui indiquer quelle peut être la meilleure solution quant au rapport qualité de la voiture/prix de la réparation. Il doit en conséquence renseigner sur l'utilité des réparations envisagées.
Le garagiste a aussi une obligation de résultat puisque, dès lors qu'il s'est engagé à réparer le véhicule, il doit le remettre en bon état de fonctionnement, à défaut sa responsabilité serait engagée. Ainsi, il sera responsable de l'accident consécutif à une mauvaise réparation. C'est au garagiste qu'il appartient d'apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute dans la réparation ou que la panne vient d'une toute autre cause.
Durant tout le temps de la réparation, le garagiste est dépositaire du bien. Il est donc considéré comme responsable du dommage causé par le véhicule qu'il a sous sa garde. Mais il est également responsable pour la disparition d'objets se trouvant dans le véhicule.
Le garagiste a également une obligation de sécurité. Il peut s'en dégager s'il n'a commis aucune faute. Il est également responsable des défauts des pièces utilisées.
Les recours
Le garagiste dispose d'un droit de rétention du véhicule en cas de non paiement de la facture.
Avant d'engager une action devant les juridictions civiles, le client peut faire une démarche amiable auprès du garagiste par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception. A défaut de réponse de ce dernier, plusieurs possibilités s'offrent à lui :
se faire aider par une association de consommateurs ;
informer les instances professionnelles du comportement du garagiste;
saisir la DDCCRF (répression des fraudes du département du garage);
saisir les tribunaux .
Si la demande est inférieure à 4 000 €, le juge de proximité du tribunal d'instance dont dépend le garagiste peut intervenir par le dépôt d'une simple déclaration au greffe. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Si la demande est comprise entre 4 000 et 10 000 €, la demande doit être adressée directement au tribunal d'instance.
Si la demande excède les 10 000 €, seul le tribunal de grande instance du lieu où se situe le garage est compétent. L'assistance d'un avocat est alors obligatoire.
Sur le même sujet
|

http://www.coin-avocat.com/blog-permis-a-point-permis-de-conduire/?p=21
La responsabilité du garagiste (juin 2005) « Maître Jean-Philippe Coin

JeanPhilippeCOIN_avocat_Automobil_google
Jean Philippe COIN
Avocat spécialisé
en droit de l’automobile
Assistance aux particuliers
Paris
____________________
29 avenue Georges Mandel
75116 Paris - France
Tel : +33 (0)1 45 05 11 00
Fax : +33 (0)1 47 27 53 77
Mob : +33 (0)6 09 92 00 84
E-mail: jp-coin@wanadoo.fr
« La responsabilité du professionnel dans la vente des véhicules (mai 2005)
Assurance Bonus Malus (juillet 2005) »
La responsabilité du garagiste (juin 2005)
La responsabilité et les obligations du garagiste
Qui d’entre nous n’a pas eu un jour un problème avec son garagiste ?
Il va sans dire que cet article ne concernera bien évidemment pas ceux d’entre nous qui ont pris soin de recourir aux services des concessions et professionnels Porsche
Cependant cette question de la responsabilité des intervenants professionnels de l’automobile est devenue d’actualité compte tenu de la tendance actuelle des tribunaux, suivant un code de la consommation renforcé, et qui condamnent très souvent les réparateurs et garagistes dès que leur responsabilité peut être retenue pour des manquements ou simplement des oublis de leur
I Le principe de l’obligation du réparateur
lorsque vous apportez votre véhicule à un garagiste ou que ce dernier intervienne après un accident à la demande de votre assureur, vous avez automatiquement un contrat avec ce dernier qui crée à votre profit un grand nombre d’obligations pour celui ci
le garagiste à alors plusieurs obligations impératives qui sont les suivantes
La réparation du véhicule
La sécurité du véhicule
Le conseil de son utilisateur
Ces obligations ont été retenues par l’ensemble des tribunaux qui retiennent le principe suivant
Le garagiste est tenu de réparer le véhicule et garantir ces réparations de façon absolue, Il doit informer son client de tous dangers risques ou problème qui pourrait se poser avec le véhicule ou qui pourrait se poser lors de sa réparation il ne doit jamais laisser repartir un véhicule pressentant des désordres sans préalablement en informer le client par écrit
Dans le cas du garagiste, la jurisprudence retient de façon absolue que le garagiste est présumé responsable de la mauvaise réparation et qu’il doit démontrer qu’il n’a pas commis de faute pour s’exonérer de cette responsabilité.
2– l’obligation de réparer
Le garagiste qui laisse entrer en son garage un véhicule pour le réparer est tenu de façon absolue de le remettre en état de fonctionnement normal et sans danger.
Il s’agit alors pour ce dernier d’une obligation de résultat que l’on oppose à une simple obligation de moyen
Il doit donc réparer le véhicule un point c’est tout et non se contenter de trouver la panne ou simplement se contenter d’essayer de la réparer au mieux
Combine de fois n’entendons nous pas un garagiste expliquer à l ‘un de ses clients « qu’il a fait au mieux pour que cela tienne jusqu’à la prochaine fois» , et bien non cela n’est plus acceptable sauf à en informer le client par écrit et avoir son accord formel
De plus ce genre de pratique ne peut exister dès que cela concerne un point relatif à la sécurité
Le principe de l’obligation de réparation est simple : si le garagiste touche au véhicule tout ce qu’il fera sera sous sa responsabilité avec une obligation absolue de résultat
Il ne peut bien évidement être tenu responsable de l’usure normale ou de la casse normale du véhicule si elle intervient par la suite
Il ne pourra pas plus être tenu responsable d’une casse qui interviendra par la suite mais sans aucun lien avec les réparations effectuées par lui
Dans son obligation absolue de réparation l’intervenant professionnel devra prouver qu’il a fait le nécessaire et qu’il a suivi scrupuleusement les instructions du constructeur
Il est devenu fréquent, lorsque après un accident grave sur un véhicule de prestige intervient une expertise de l’épave du véhicule, que l’on recherche l’ensemble des professionnels ayant eu à intervenir sur ce véhicule et ce depuis l’origine afin de vérifier si chaque intervention a été effectuée normalement et si les causes de l’accident ne sont pas imputables à une intervention d’un garagiste 10 ans avant l’accident
Chaque garagiste ou professionnel devra alors justifier de son intervention des factures payées des changements de pièce effectués et des observations et réserves faites alors au client
3 – L’obligation de conseil
*Le garagiste outre ses réparations est tenu de l’obligation de conseil qui est devenue absolue en matière de sécurité
Non seulement un garagiste doit informer son client de tous désordres sur le véhicule mais il doit lui faire connaître de façon claire et précise l’ensemble des risques qu’il encourt en matière de sécurité
Il ne peut ainsi par oubli ne pas avoir tenu informé son client de ce que les systèmes de frein de son véhicule parce que trop ancien pouvait se révéler défaillant (Cour de Cassation )
Il ne fait plus aucun doute que tout client qui aurait un accident de circulation juste après avoir repris son véhicule dans un garage pourrait se retourner contre ce garage et obtenir des dommages et intérêts conséquents et ce devant n’importe quel juge
Le garagiste doit mettre en garde son client contre toutes les conséquences du mauvais fonctionnement d’une partie du véhicule surtout en matière de sécurité
Le garagiste doit prévenir le client sur le fait que la réparation nécessaire à la remise en l’état du véhicule pourrait être trop onéreuse compte tenu de la valeur vénale du véhicule
Concernant ces obligations de conseil et d’assistance le garagiste devra prouver de façon formelle devant les juges saisis qu’il a bien rempli ces obligations
Et en ce cas comme nous le rappelons toujours seule la preuve écrite existe et sera retenue
Ainsi le garagiste devra produire des documents écrits pour voir sa responsabilité écartée
Il n’est pas inutile de rappeler que cette preuve outre les factures des interventions résulte bien souvent de la production des OR (ordre de réparation)
il est donc impératif, tant pour le client que pour le garagiste, et ce avant toute intervention de faire signer au client un OR qui le plus détaillé et le plus précis possible car bien souvent seul ce document permet de prouver ce qui a été prévu retenu et expliqué entre le client et le professionnel
pour tous nouveaux travaux ou interventions ou réserves en cours de réparation il convient de signer un nouvel OR
L’obligation de ce »t OR n’est en rein une simple formalité puisque c’est sur ces seuls OR que l’on peut connaître, du respect ou non, par le réparateur de ses obligations notamment en matière de sécurité
4 – L’obligation de sécurité
Il s’agit actuellement et sans nul doute de la plus importante des obligations du garagiste
Le garagiste ne peut échapper à sa responsabilité même en prouvant qu’il n’a pas commis la moindre faute.
Le simple fait de laisser repartir un véhicule présentant un danger quelconque engage sa responsabilité
Et même dans le cadre de désordres pour lesquels il n’est pas intervenu ni n’a effectué la moindre réparation il doit en informer son client
Ainsi un garagiste qui aurait eu à faire une simple vidange et entretien de routine sur un véhicule et n’aurait pas signalé à son propriétaire que le système de freinage présentait des désordres visibles ou n’aurait informé que verbalement le client des désordres pourrait être tenu responsable de tous dommages en cas d’accident du véhicule qu’il aurait eu entre les mains
Il va sans dire que tous désordres causés par le garagiste lui-même lors de l’une de ses interventions et mettant à mal l’utilisation d’un des éléments de sécurité du véhicule sera condamné par les juges tant au titre de l’obligation de réparation que de celle de sécurité
L’arrêt de principe a été rendu dans une espèce où le client avait perdu le contrôle de son véhicule et occasionné un accident dû selon l’expert à la non remise en place d’un frein d’écrou au cours d’une précédente réparation.
Le garagiste a été déclaré responsable non seulement des dommages matériels et corporels subis par son client, mais également de ceux qu’il avait occasionné aux tiers impliqués dans l’accident.
Il est important de préciser que le garagiste peut également être poursuivi sur un plan pénal pour mise en danger de la vie d’autrui, blessures ou homicides involontaires.
5 L’obligation élargie du garagiste dans ses interventions, pour le compte d’autrui
non seulement le garagiste est responsable pour ses actes et manquements mais il l’est aussi vis à vis de son client pour tous manquements de ses intervenants et sous traitants, à charge pour lui de se retourner contre ces derniers en cas de problème
enfin le garagiste est responsable envers son client pour tous manquements de ses fournisseurs en cas de défaillance de l’une ou l’autre des pièces utilisées pour procéder à ses réparations à charge toujours pour lui de se retourner contre son fournisseur, l’usine ou son réseau
Compte tenu de ces quelques explications il apparaît comme de plus en plus évident que le garagiste réparateur est in fine responsable dès qu’un problème se pose sur un véhicule qu’il aura eu entre les mains !!!
cependant il existe encore et fort heureusement des limites à cette responsabilité déjà très étendue
en effet les juges considèrent encore que le garagiste ne peut être tenu responsable de la vétusté d’un véhicule même s’il est intervenu sur ce dernier
de plus il ne pourra être tenu responsable de la casse d’organes mécaniques du véhicule, sur lesquels il n’est jamais intervenu et pour lesquels il n’était pas tenu d’intervenir au titre d’un entretien normal prévu par le constructeur
en outre aucun juge n’acceptera de condamner un professionnel pour des fautes commises par l’utilisateur lui-même
il n’est en effet pas possible de reprocher à votre garagiste une casse moteur ou celle d’une boite si vous avez pris soin d’utiliser votre véhicule sans huile et comme un cochon
l’utilisateur du véhicule est alors pleinement responsable de ses fautes ce qui finalement est assez normal et ce qui constitue aujourd’hui la seule limite à la responsabilité d’autrui pour ses seules et propres erreurs
l’état d’entretien dans lequel restent nos chères voitures résulte autant des interventions des professionnels à qui nous les confions que de l’usage respectueux que nous en faisons tous les jours
Questions du mois
Colette B.
Monsieur,
Suite à un article paru dans RS Magazine de janvier 2005, je me permets de solliciter votre avis concernant 2 contraventions pour excès de vitesse : .
En septembre 2004 excès de vitesse limitée à 90 km/h, enregistrée à 107 et retenue à 101 km/H pour laquelle j’ai demandé le document photo déterminant ce PV (pas de réponse à ce jour).
En février 2005 : enregistrée à 83 km/ H - limitée à 70 km/H vitesse retenue après application de la marge technique : 78 km / h. amande = 45 euros. perte de points = OUI
IL me semblait qu’un excès de vitesse NON supérieur à 20 km/H, n’entraînait pas de perte de points, Pourriez-vous m’indiquer la conduite à tenir afin d’éviter la perte de points lors de ces 2 contraventions ? En vous remerciant vivement par avance
Comme nous avons eu à le publier dès l’annonce de Noël passée les promesses n’engagent que ceux qui y croient et les mesures annoncées officiellement par notre gouvernement n’ont bien évidemment pas eu de suite autre que cet effet d’annonce
Le seule mesure définitivement adoptée à été un alourdissent des peines pour les grands excès de vitesse
Comme nous l’avons donc écrit à la demande de très nombreux lecteurs qui nous interrogent sur ce point la règle est donc la suivante et ceci bien évidement jusqu’à une prochaine aggravation
Article R 413-14 du code de la route modifié
III. – Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d’un point.
Nous ne pouvons, et ce comme nous vous l’indiquons quasiment tous les mois dans cette revue, que vous rappeler notre position de principe et s’agissant de tous les excès de vitesse verbalisés, qui est celle de vous encourager à contester de façon systématique toutes les infractions et amendes lorsqu’il n’est pas prouvé de manière absolue que vous en êtes l’auteur identifié de façon formelle
Monsieur Benoît X de Cormeilles en Parisis 95
J’utilise depuis quelques années ma PORSCHE 996 cabriolet immatriculée à l’étranger ou mes grands-parents vivent et ont leur domicile
Je ne paye pas les contraventions de stationnements qui sont laissées régulièrement sur mon pare brise et mes grands-parents ne reçoivent jamais aucun avis de paiement
Cependant j’ai été flashé à 110 km h sur le périphérique parisien il y a 8 jours
Je n’ai encore rien reçu, est ce que je risque des poursuites et ferais je l’objet de poursuites, l’adresse de mes grands-parents (qui existe) ou est immatriculée le véhicule
J’ai entendu dire que des poursuites sont possibles au niveau de la communauté européenne
S’agissant préalablement de vos simples amendes de stationnement je ne peux que comprendre votre attitude et vous confirmer qu’à ce jour qu’aucun recoupement ni poursuite ne sont réellement organisés à ce titre entre les différents pays de la communauté
Il nous est loisible pour tous dans nos villes de relever chaque jour que nombre d’étrangers, qui ne le sont pas plus que vous et moi utilisent des plaques d’immatriculations de circonstances et oublient sur la voix publique les amendes déposées sur leurs pares brises par des contractuelles qui n’ont jamais bien compris à quoi correspondent les plaques des véhicules qu’elles verbalisent (il est vrai qu’il faut préalablement avoir appris à lire pour cela)
Dans le cas de la photographie, qui a été faite de votre véhicule, par un appareil automatique, son sort sera identique à celui de vos contraventions puisque vous n’aurez guère de craintes de recevoir un avis de contravention chez vos grands-parents à l’étranger
Il est assez certain que cette situation ne saurait encore durer de longues années du moins pour les pays de la communauté ou d’autres pays tels que les états unis, mais il est néanmoins vrai que le refus de la ratification du traité communautaire par la France ces dernières semaines aura au moins cela de bien
Cependant n’oubliez jamais qu’en cas de contrôle avec verbalisation immédiate au bord de la route, les règles sont différentes et c’est le conducteur du véhicule arrêté qui est directement l’objet des poursuites et sanctions, à charge pour lui de s’expliquer sur l’usage d’un véhicule immatriculé dans un autre pays
La solution qui reste envisageable est de posséder possédant une plaque d’immatriculation et un passeport diplomatique d’un petit état très lointain et inconnu tout en apprenant la langue du pays en question pour pouvoir répondre dans une langue incompréhensible des policiers en cas d’interpellation (ce qui ne devrait sur ce point ne pas être trop difficile !!!!)
L’astuce du mois : la Porsche D’ENZO suite et fin
Certain de nos lecteurs après avoir lu l’article de notre numéro de mai nous ont signalé des solutions pour éviter la perte par trop rapide de leurs 12 points du permis de conduire,
nous vous les donnons sans plus de garantie, que de commentaire mais elles démontrent que face à des mesures pour le moins démagogiques et abusives il reste des solutions imprévues
il est bien évident que comme nous ne cessons de la rappeler, par précaution, nous ne veillons jamais à encourager quelque solution que ce soit pour ne pas respecter la loi etc, etc, etc.si vous avez des solutions que vous aimeriez faire partager à l’ensemble de la communauté Porschiste n’hésitez pas à nous écrire
Madame Annick L de PARIS :
J’ai enfin pu prendre possession de mon nouveau cabriolet 997 que j’ai aussitôt immatriculé au nom de jeune fille de mon épouse
Monsieur César C de Paris
J’ai immatriculé ma dernière acquisition (996 S4 cabriolet ) à mon nom et à celui de mon épouse en 2003
Lorsque nous recevons un avis de contravention suite à une infraction contrôlée par radar automatique nous donnons alternativement soit mon nom soit celui de mon épouse ce qui nous fait un total de 24 points et deux fois plus de chance de garder notre permis de conduire (mon épouse ne conduit en outre que très rarement et pour sa part dispose encore de plus de 8 points ce qui n’est plus mon cas depuis fort longtemps
Questions de remplacement
J’ai été flashé par l’arrière pour un excès de vitesse de 17 km/h sur une voie rapide (limitée à 110 km/h).
Lorsque je me suis présenté au tribunal, le procureur qui était jusque là relativement modéré est littéralement devenu hystérique me traitant d’assassin et m’accusant de tous les maux de la terre. Voyant que je ne m’énervais pas, il a refusé de prendre en compte les preuves que j’avais avec moi pour démontrer que je ne pouvais être au volant sous prétexte que j’essayais d’utiliser la loi à mon profit (je ne savais pas que c’était interdit !).
Finalement, sans avoir pu placer un mot pour ma défense, j’ai été condamné au maximum (450 Euros).
Je tiens à vous précise que j’étais venu sans avocat, persuadé de tomber sur des gens de bonne foi, pas d’être la victime d’un règlement de compte !
Bien entendu, je compte faire appel, mais j’aimerais savoir si ce genre d’attitude est courant et comment réagir face à un tel comportement indigne de ceux qui prétendent rendre la justice en toute sérénité et impartialité…
L’aventure vécue par notre lecteur n’est pas et de loin un cas isolé sur l’attitude et l’accueil réservée à un automobiliste auteur d’un simple acte contraventionnel
Il est assez fréquent que les auteurs de telles infractions se voient traités de véritables criminels bien plus dangereux que des voyous attaquant à plusieurs « une vieille pour lui piquet son sac »
Comme nous vous l’avons sans cesse répété, le juge qui sera appelé à vous entendre en vos explications peut vous réserver un accueil des plus désagréable et rendre un jugement sur son intime conviction et suivant des motivations qui il est vrai ne regardent que lui
En l’espèce notre lecteur eut été avisé de recourir aux services d’un avocat spécialisé et ne pas se déplacer à cette audience compte tenu d’empêchements bien évidement « réels »
En effet les juges sont, la plus part du temps, enclins à écouter, sans trop y croire et même avec le sourire, un avocat raconter ce qu’ils ne peuvent tolérer d’un simple justiciable même de bonne foi
Cette règle n’est certes pas juste mais c’est ainsi et notre lecteur eut été avisé de s’en souvenir avant !!!
S’agissant enfin du droit d’appel qui est en l’espèce totalement justifié ce droit doit être exercé dans un délai impératif de 10 jours à compter du prononcé du jugement
En conclusion et même si cela n’est pas gratuit il vaut mieux envoyer son avocat devant un tribunal plutôt que d’y aller sois même !!!!!
Actualité
le contrôle radar provoque deux morts le samedi 30 avril 2005.
Un véhicule de la gendarmerie du peloton autoroutier de Luc en Provence a provoqué, un carambolage qui s’est soldé par la mort de deux personnes et en a laissé une autre blessée.
Cet accident tragique s’est produit dans la nuit de mercredi à jeudi 28 avril 2005, alors que le véhicule de la gendarmerie était stationné, tous feux éteints à la sortie d’un virage sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A 57 près de Toulon (Var).
Le break Mégane banalisé équipé d’un radar automatique embarqué, était en train de procéder à des contrôles de vitesse, à un endroit « accidentogène » : (Solliès-Pont)
Peu après minuit il a été percuté par une Fiat Punto, conduite par un jeune conducteur de 23 ans.
Sous le choc, avec ce véhicule non signalé, la Fiat s’est retrouvé en travers de l’autoroute, sur les voies de circulation. 5mn seulement après cette première collision, la FIAT a été percutée à son tour par une Peugeot 205.
Bilan : les deux occupants de la FIAT sont morts et une passagère de la Peugeot a été blessée.
le code de la route est formel, le véhicule de la gendarmerie, n’avait rien à faire sur cette BAU , surtout qu’il avait volontairement oublié de signaler sa présence par des balises ou tout autre dispositif lumineux
il semblerait (sous toutes réserves) que la direction nationale de la gendarmerie, confirme cette version des faits, en affirmant dès le vendredi 29 avril que la voiture des gendarmes ne devait pas stationner à cet endroit, ce qui étonne d’autant puisque s’agissant de militaires ceux ci ne peuvent intervenir ni agir sans ordres de mission
Le même jour que ce terrible accident On apprenait, que le groupement de gendarmerie des Hautes Alpes avait posté 31 gendarmes aux bords des routes, pour faire la chasse aux automobilistes qui signalent les contrôles radars par des appels de phare.
Rappelons ici aux services de gendarmeries qui oublient sans nul doute le droit applicable que :
* La bande d’arrêt d’urgence (BAU) : est une partie d’un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l’arrêt ou le stationnement des véhicules ;
*le code prévoit alors qu’il est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sur les BAU , sauf cas de nécessité absolue ;
Tout conducteur se trouvant obligé malgré lui et dans la nécessité absolue d’immobiliser son véhicule doit alors le faire et dans tous les cas en assurant la pré signalisation de son véhicule.
Enfin si il n’est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d’urgence le dégagement de l’autoroute.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Pour notre part nous ne pouvons accepter toute conduite irresponsable sur la route que cela soit le fait d’un automobiliste (même au volant d’une Porsche) ou des gendarmes chargés d’une mission de sécurité et de service publique
Ce tragique accident nous oblige à rappeler à tous les règles de prudence nécessaires à un usage paisible de la route ainsi que de dénoncer avec force tout abus dont nous pourrions être l’objet par de tels contrôles illégaux effectués au mépris des règles de droit et du respect de la vie d’autrui
Il est enfin évident que si vous êtes l’objet de tels contrôles vous pouvez contester devant les juges dans le cadre d’une procédure leur validité et leur régularité, privant ainsi les procédures engagées à votre encontre de base légale
La règle est simple : il n’est pas de contrôle régulier sans respect absolue des règles légales !!!
|
Réparation : les obligations du garagiste - Droit-Finances

Garagiste_Réparation_les_obligations_goog
En cas de réparation, le garagiste est soumis à une obligation d'information et de résultat. Le point sur la réglementation et les conditions de mise en cause de sa responsabilité.
Tarifs Ordre de réparation Devis de réparation Facture Pièces Autres obligations à la charge du garagiste
Responsabilité du garagiste
Obligation de résultat
A lire aussi: Garantie réparation garage
En France, le Code de la consommation prévoit généralement des dispositions visant à protéger le client face au professionnel. Il en va ainsi en raison du fait que le client est généralement perçu comme un profane, et qu'il ne doit par conséquent pas se trouver dans une situation trop déséquilibrée face à un professionnel. Le secteur de la réparation automobile est à cet égard, particulièrement réglementé.
Tarifs
Le garagiste est soumis, comme n'importe quel professionnel, à une obligation d'information concernant le coût de ses prestations. Il doit donc informer le client de manière claire et visible des tarifs qu'il pratique. Pour cela, il doit donc afficher les tarifs TTC (toutes taxes comprises) sous forme de taux horaires TTC et de prix TTC, à l'entrée de son garage, ainsi que dans le lieu destiné à l'accueil des clients. Ces informations renseignent donc le client sur le taux horaire de main-d'oeuvre pratiqué.
Dans le cas de forfaits, le garagiste doit indiquer le prix TTC de la prestation comprenant le coût des pièces et de la main-d'oeuvre.
Les conseils d'Eric Roig, directeur-fondateur de droit-finances.net
En France, le Code de la consommation prévoit généralement des dispositions visant à protéger le client face au professionnel. Il en va ainsi en raison du fait que le client est généralement perçu comme un profane, et qu'il ne doit par conséquent pas se trouver dans une situation trop déséquilibrée face à un professionnel. Le secteur de la réparation automobile est à cet égard, particulièrement réglementé.
Les conseils d'Eric Roig, directeur-fondateur de droit-finances.net
|
RESPONSABILITÉ DU RÉPARATEUR
Responsabilité du réparateur : Le lien de causalité entre la panne et l'intervention du garagiste
01/2013 - n° Revue : 0847
Rubrique : Jurisprudence JA | Sous-Rubrique : Commerce et services de l'automobile
LucGrynbaum_professeur_'universite_Paris_Descartes
Luc Grynbaum, professeur à l'université Paris-Descartes, doyen honoraire de la faculté de droit de La Rochelle
DR
Il appartient au client qui recherche la responsabilité de son garagiste lors de la survenance d'une nouvelle panne de prouver que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité existante au jour de l'intervention du garagiste ou qu'ils sont reliés à celle-ci.
Une des facettes de la responsabilité du garagiste réparateur était évoquée dans l'arrêt que nous analysons ici : le lien entre son intervention et une nouvelle panne. Un garagiste avait réparé une boîte de vitesses en 2004. De nouvelles pannes étaient intervenues en 2006. Une expertise a montré qu'il convenait de les attribuer à une oxydation. La question était de savoir si le garagiste aurait dû détecter celle-ci en 2004 ou bien si cette détérioration était apparue ultérieurement. De manière plus théorique, il convenait d'abord de déterminer si une panne consécutive à une réparation effectuée par un garagiste était liée à son intervention et, ensuite, si ce dernier aurait dû détecter le défaut qui allait provoquer les nouvelles pannes.
____________________________________________________________________________
Il faut que le demandeur montre que l’intervention du garagiste portait sur l’élément défaillant ou que cette défaillance devait être détectée par lui lors de la première intervention pour que la panne trouve son origine dans cette première intervention
Ces questions sont étroitement liées à l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste. L'intérêt que présente cet arrêt réside dans une petite complexité supplémentaire que présente l'espèce. Il fallait en outre déterminer si les conditions d'utilisation du véhicule entre la première intervention et la panne étaient de nature à expliquer les nouvelles pannes. L'affaire se compliquait donc de la question du lien de causalité entre le dommage, les nouvelles pannes et le fait générateur de responsabilité qui aurait résidé dans l'intervention du garagiste.
_______________________________________________________________________________________
Une présomption de causalité de droit et non de fait
L'obligation de réparation qui pèse sur le garagiste est une obligation de résultat (par exemple Com., 20 mars 1985, RTD civ. 1986, p. 632, obs. Ph. Rémy ; V. S. Hocquet-Berg, Garagiste, J.-Class. Responsabilité civile et assurance, Fasc. 385, n° 20 et s.). Cette qualification reposerait sur l'absence d'aléa (V. Ph. Rémy, obs. sous Com., 20 mars 1985 ; RTD civ. 1986, p. 362). Toutefois, il est possible de nuancer cette affirmation en relevant que l'obligation du garagiste réparateur n'est pas tout à fait de résultat puisqu'il peut s'exonérer en démontrant son absence de faute (S. Hocquet-Berg, op. cit. n° 22). Elle n'est pas non plus une simple obligation de moyens, car la charge de la preuve de la mauvaise exécution du service (la réparation d'une panne) est inversée au profit du demandeur, le garagiste étant le technicien supposé détenir le savoir (ibid.).
C'est la manière d'appréhender le lien de causalité qui est centrale dans l'arrêt du 31 octobre 2012. Cette analyse permettra de comprendre sur qui pèse la charge de la preuve de la relation causale entre la nouvelle panne et la réparation intervenue. Sur ce point, la Cour de cassation affirme que « l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage » (Civ. 1re, 22 juin 1983, RTD civ. 1984, p. 119, obs. Ph. Rémy. - Com., 20 mars 1985, préc.). Cette présomption de causalité serait une présomption de droit et non de fait (S. Hocquet-Berg, op. cit. n° 24). Elle fonctionne très bien quand la panne persiste immédiatement après la réparation. Cette présomption s'amoindrit considérablement avec l'écoulement du temps, pour même disparaître.
En effet, la jurisprudence indique que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat » (Com., 22 janvier 2002, n° 00-13.510). Il s'ensuit de cette présomption que le demandeur doit prouver que « la panne résulte d'un élément du véhicule sur lequel est intervenu le garagiste, et c'est alors seulement que la défaillance de cet élément est présumée avoir pour origine une mauvaise réparation » (S. Hocquet-Berg, op. cit. n° 26).
____________________________________________________________________________
C'est la raison pour laquelle, quand la cause du sinistre reste indéterminée, le garagiste ne voit pas sa responsabilité engagée (Civ. 1re, 16 octobre 2001 : Bull. civ. I, n° 259).
La Cour de cassation relate les faits révélés dans l'expertise pour souligner que le véhicule n'aurait pas pu parcourir 12 000 kilomètres en onze mois si les fourchettes de la boîte de vitesses avaient été oxydées au jour de la réparation
_______________________________________________________________________________________
La théorie de la causalité adéquate
Il faut donc que le demandeur montre que l'intervention portait sur l'élément défaillant ou bien que cette défaillance devait être détectée par lui lors de la première intervention pour que la panne consécutive trouve son origine dans cette première intervention. C'est ainsi qu'il a pu être jugé que le client ne démontrait pas que le défaut de fixation d'une boîte de vitesses était lié à l'intervention du garagiste cinq ans plus tôt, après que près de 100 000 kilomètres ont été parcourus (Civ. 1re, 14 décembre 2004, n° 02-10.179, Resp. civ. et assur. 2005, comm. 59). Il semble donc que l'écoulement du temps et le nombre de kilomètres parcourus distendent considérablement la causalité. Plus l'usage du véhicule a été intensif et plus le temps a passé, moins la présomption de causalité entre l'intervention du garagiste et la seconde panne est efficace.
Dans la présente affaire, les auteurs du pourvoi relevaient parfaitement que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et que la cour d'appel ne devait pas faire peser la charge de la preuve de la faute sur le client.
Toutefois, en matière de cause du dommage, en présence d'une incertitude « scientifique » sur l'origine de la défaillance technique, la théorie de la causalité adéquate doit trouver à s'appliquer. Cette méthode suppose de rechercher la cause principale du dommage, c'est-à-dire la cause la plus probable de déclenchement du dommage (G. Viney, P. Jourdain, « Les conditions de la responsabilité », 2e éd. LGDJ 1998, n° 338 et s.). En contexte d'incertitude scientifique, cette méthode est préférée à la théorie de l'équivalence des conditions (M. Bacache-Gibeili, « La responsabilité civile extracontractuelle », Éd. Économica 2007, n° 386). On rappellera que la théorie de l'équivalence des conditions postule que tous les éléments qui ont concouru au dommage constituent la cause du dommage (Ph. Brun, « Responsabilité civile extracontractuelle », Éd. Litec 2005, n° 208).
Or, dans la présente affaire, il n'est pas possible de considérer qu'à la fois l'intervention du garagiste et l'usage intensif du véhicule sont à l'origine de « l'oxydation ». De deux choses, l'une : soit cette oxydation était présente lors de l'intervention de 2004 et le garagiste aurait dû la voir, soit elle est apparue ultérieurement. C'est donc bien la théorie de la causalité adéquate qu'il convenait de mettre en oeuvre pour trouver la solution au litige.
L'érosion temporelle de la preuve
L'arrêt permet de mettre en lumière que la mauvaise réparation constatée immédiatement après l'intervention engage bien la responsabilité de plein droit du garagiste parce qu'il est débiteur d'une obligation de résultat. En revanche, pour que la responsabilité d'une nouvelle panne lui soit imputée, il faut que le client démontre le lien de causalité entre la panne et son intervention. Une fois l'existence de ce lien démontrée, sans doute que l'obligation de résultat reprend sa place. Il reste que le temps passant, il est de plus en plus difficile pour le client de rapporter la preuve de ce lien.
La Cour de cassation, dans le présent arrêt, affirme nettement cette solution, en soulignant qu'« il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ».
La Cour de cassation, dans notre affaire, relate les faits révélés dans l'expertise pour souligner que le véhicule n'aurait pas pu parcourir 12 000 kilomètres en onze mois si les fourchettes de la boîte de vitesses avaient été oxydées au jour de la réparation. Le garagiste ne pouvait donc pas s'en apercevoir et prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire avertir le client. Ici, la théorie de la causalité adéquate ne bénéficie pas au demandeur, elle permet au contraire d'écarter la responsabilité du prestataire de services.
En conclusion, on rappellera que dans les affaires de pannes consécutives à une première réparation, il appartient au client demandeur de prouver le lien de causalité entre la panne et l'intervention du garagiste, en ayant recours à la théorie de la causalité adéquate. L'écoulement du temps diminue considérablement les chances d'établir ce lien.
La décision
Civ. 1re, 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Anne-Marie X., à M. Robin X. et à Mme Chloé X. de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Auto Roussillon pièces outillages (ARPO) ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2011), que les époux X. ont fait procéder, en décembre 2004, à la réparation de la boîte de vitesses de leur véhicule par la société Saint-Charles automobiles (la société) ; que de nouvelles pannes étant survenues en novembre 2005 et mars 2006, Daniel X., puis, à la suite de son décès, ses ayants droit, et Mme X. (les consorts X.), après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, ont recherché la responsabilité du garagiste ; Attendu que les consorts X. font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en rejetant les demandes des consorts X. au motif qu'il n'était pas établi qu'en décembre 2004 l'oxydation de la boîte de vitesse existait déjà et que le garagiste aurait dû la découvrir lors de cette intervention, quand ce motif ne caractérise pas le fait que le garagiste aurait établi qu'il n'avait alors pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser sur les consorts X. la charge de prouver l'existence d'une faute commise par le garagiste, en violation de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ; qu'ayant relevé que le véhicule avait parcouru, sur une période de onze mois, près de 12 000 kilomètres entre la dernière intervention de la société et la nouvelle panne et que, selon l'expert judiciaire, il n'était pas possible que le véhicule eût pu parcourir normalement une telle distance avec des axes de fourchettes oxydés, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que cette oxydation, à l'origine des désordres affectant la boîte de vitesses, existât déjà en décembre 2004 ni que la société eût dû la découvrir lors de son intervention ; que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a pu en déduire que le dommage n'était pas imputable à un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X. aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X. ; les condamne à payer à la société Saint-Charles automobiles la somme de 2 500 € ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
|
ACCORDS COMMERCIAUX DANS L'APRÈS-VENTE
Les relations du réparateur avec l'assureur et l'expert automobile
05/2011 - n° Revue : 0829
LucGrynbaum_professeur_'universite_Paris_Descartes
Luc Grynbaum (1), professeur à l'université Paris-Descartes, directeur du master 2 Santé, prévoyance et protection sociale, doyen honoraire de la faculté de droit de La Rochelle
DR
La mise en place d'accords entre professionnels représente une méthode intéressante pour fixer les bonnes pratiques d'un secteur d'activité et réduire d'éventuelles tensions en dégageant les obligations essentielles de chacun. Toutefois, le souci de réduire les coûts conduit à ce que ces engagements, qui ne sont pas juridiquement contraignants, ne soient pas toujours respectés. Leur violation ne reste pas pour autant sans conséquence.
Bien que l'assuré soit libre de faire réparer son véhicule chez le carrossier de son choix, les assureurs ont développé des accords avec des carrossiers pour orienter leurs assurés. Il semble que la dissuasion de l'assuré de faire effectuer sa réparation par un non-agréé s
À la suite d'une collision, le réparateur chargé de procéder aux interventions nécessaires a longtemps été choisi par l'assuré. Les travaux et leur montant étaient définis après la visite de l'expert désigné par l'assureur. Le client payait grâce à l'indemnité qu'il recevait de ce dernier. L'assureur pouvait également régler directement le réparateur sur le fondement d'une indication de paiement. Ce schéma est aujourd'hui largement remis en cause. Il ne subsiste guère que dans les zones rurales, où la proximité d'un réparateur unique ou la relation de confiance incite l'assuré à s'adresser à « son garage ».Dans les zones urbaines ou périurbaines, l'automobiliste qui subit une collision entre, le plus souvent, en contact avec le gestionnaire de sinistres de son assureur, qui l'oriente vers un réparateur agréé par celui-ci. L'argument essentiel réside dans le paiement direct par l'assureur de la réparation au garagiste.
Cette démarche de « référencement » des réparateurs par les assureurs est concomitante d'une politique de même nature menée à l'égard des experts automobiles, qui ont conclu avec les assureurs des partenariats privilégiés (2). L'objectif de l'assureur de ne plus payer « en aveugle » et même de peser sur les coûts explique aisément cette volonté de mieux contrôler la tarification pratiquée par les destinataires finaux des prestations versées par l'assureur. Toutefois, la mise en réseau d'experts et de réparateurs agréés éloigne le propriétaire du véhicule de l'idée de choix des prestataires qui vont intervenir dans le processus de réparation.
La petite réparation sans expertise
Il est vrai que, concernant l'expert, celui-ci est considéré depuis longtemps comme le « mandataire » de l'assureur, dans le sens où il doit vérifier l'étendue des dommages imputables au sinistre déclaré par l'assuré et veiller à ce que le montant des travaux n'excède pas la valeur du véhicule. Ces contrôles bénéficient davantage à l'assureur qu'à l'assuré. À l'égard de ce dernier, il doit toutefois s'assurer que les réparations envisagées par le garagiste sont de nature à maintenir la sécurité du véhicule. On comprend donc que le processus d'agrément par l'assureur des experts automobiles est accepté depuis bien longtemps, bien qu'il puisse susciter des difficultés quant à la mise en oeuvre du principe d'indépendance qui gouverne la profession (3), qu'il s'agisse de la dimension déontologique ou financière de cette indépendance. L'annonce par des assureurs automobiles occupant une place importante sur le marché de leur volonté d'amoindrir l'intervention des experts pour la remplacer par un accord direct avec le réparateur pour les « petites réparations » n'est évidemment pas de nature à rasséréner cette profession.
Les réparateurs, quant à eux, ont dû faire face plus tardivement à ce souci d'abaissement des coûts manifesté par les assureurs. Nous observerons tout d'abord la pratique de l'agrément du réparateur par les assureurs. Nous évoquerons ensuite les initiatives d'autorégulation par les acteurs du secteur. Nous verrons enfin qu'en présence d'un éventuel contentieux, l'arsenal législatif s'est développé.
La pratique de l'agrément
Bien que l'assuré soit libre de faire réparer son véhicule chez le carrossier de son choix et que ce principe ait été réaffirmé par le Comité économique et social européen (4), les assureurs ont développé des accords avec des carrossiers visant à orienter leurs assurés vers ces derniers. Cette pratique revêt le nom générique d'« agrément ». C'est ainsi que, en 2007 déjà, selon un rapport de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), 70% des carrossiers étaient agréés, parmi lesquels 29% étaient indépendants, 18 % appartenaient à un réseau de constructeur automobile et 23% à un réseau de carrosseries.
Des clients contre un barème
L'agrément présente des avantages pour trois des parties impliquées dans l'opération de réparation. L'assuré ne règle pas directement son réparateur, le paiement étant effectué par l'assureur. Ce dernier maîtrise ses coûts, car les tarifs de réparation sont prédéfinis dans la convention d'agrément. Ensuite, l'agrément se réalise, le plus souvent, sur la base d'exigences techniques, de qualité de prestation, notamment l'accueil et le prêt à l'assuré d'un véhicule de remplacement. Enfin, le carrossier est susceptible d'accroître ou de « garantir » son niveau de clientèle, car l'assureur oriente les assurés vers ses carrossiers agréés.
On a pu constater que l'agrément est négocié le plus souvent à un niveau local par des représentants de l'assureur, ou bien au niveau national pour les réseaux constructeurs. La difficulté n'intervient pas à ce moment de la relation entre l'assureur et le réparateur agréé. C'est lors des demandes par le carrossier de voir réévaluer les tarifs préférentiels consentis à l'assureur que les désaccords, voire les conflits, se font jour. En effet, le coût de la réparation est tributaire de paramètres qui sont extérieurs à la relation entre le réparateur et l'assureur. Néanmoins, le montant payé par l'assureur au réparateur agréé en lieu et place de l'assuré fait l'objet d'un encadrement prévu par la convention d'agrément.
Le carrossier pratique des prix dits « publics », qui tiennent en un taux horaire de main-d'oeuvre et un coût de pièces. Les travaux de peinture sont facturés en coût horaire, incluant le prix de la matière. Le profit du carrossier réside donc dans la différence entre son coût d'exploitation et son tarif horaire, et sur la marge qu'il réalise sur les pièces. Or, pour ces dernières, les carrossiers qui n'ont pas développé d'activité de concessionnaire sont tributaires du prix fixé par les constructeurs, le marché de la pièce détachée hors constructeur étant encore peu développé. En ce qui concerne le taux horaire qui permet la rémunération du savoir-faire du réparateur, le montant est, en principe, libre. Néanmoins, la durée de la réparation est encadrée par les constructeurs, qui publient des barèmes établissant un temps par type de réparation. Experts et assureurs se tiennent le plus souvent à ce temps constructeur.
La remise de pied de facture
La convention d'agrément entre l'assureur et le réparateur porte sur ces paramètres et influe sur les modalités selon lesquelles le réparateur établira son coût et sa facture. Il est d'abord établi un taux horaire entre le carrossier agréé et l'assureur, lequel est inférieur au « prix public ».De surcroît, il a été constaté qu'il est pratiqué une remise consentie par le carrossier, dite sur « pied de facture », qui se justifie par un commissionnement de l'assureur, en général de 5 %. Cette remise peut prendre deux formes : son montant apparaît sur chaque facture, ou bien l'assureur prélève sa commission au moment du règlement au réparateur, émettant alors une facture de commissionnement. Quand l'assureur a recours à une plate-forme de gestion de sinistres extérieure à son entreprise, il a été constaté que cette plate-forme demandait également une « remise sur pied de facture », à titre de commissionnement.
Enfin, des services sont demandés par les assureurs aux réparateurs agréés, comme la mise à disposition d'un véhicule de remplacement (5). Souvent, ces services ne font l'objet d'aucune facturation aux assureurs, ces derniers considérant que le taux horaire négocié en tient compte. D'autres prestations non facturées se développent, comme la prise en charge et la restitution du véhicule à réparer au domicile ou au lieu de travail de l'assuré. La même prestation est demandée pour le véhicule de courtoisie.
La recherche d'une autorégulation
La pression exercée sur les prix et les difficultés structurelles des réparateurs les ont conduits à tenter de réduire les tensions par une autorégulation. La baisse du nombre des collisions, le coût du renouvellement des matériels et le contrôle strict, par les assureurs, des prix pratiqués par leurs réparateurs agréés ont provoqué des tensions entre ces derniers et les assureurs. En outre, les réparateurs présentent une structuration très disparate. On trouve, d'une part, des entreprises de quelques salariés ayant une grande difficulté à mettre en place une gestion de leurs coûts et pour lesquelles les nouveaux investissements sont impossibles. Elles coexistent avec de grandes entreprises très bien gérées, pour lesquelles la carrosserie ne constitue qu'une activité associée à la vente de véhicules au travers d'une concession. Les assureurs, quant à eux, ont connu des rapprochements qui leur ont donné un plus grand poids dans les discussions avec les réparateurs.
Travaux un peu trop dirigés
Dans les relations entre réparateurs et assureurs, l'un des premiers points de tension réside dans l'orientation des assurés vers le réseau des réparateurs agréés (6). Il semble que la dissuasion de l'assuré de faire effectuer sa réparation par un non-agréé soit réalisée avec plus ou moins de mesure selon les assureurs. Cette volonté d'orientation semble encore plus forte lorsque la gestion de sinistre est confiée à un prestataire extérieur, qui, lui aussi, est commissionné. En outre, les assureurs semblent réticents à mettre en place la cession de créance au profit des réparateurs non agréés, laquelle permettrait à leurs clients d'éviter l'avance du paiement. Or, l'orientation de l'assuré vers un réparateur agréé en tenant un discours péjoratif sur le réparateur habituel de l'assuré est constitutive de concurrence déloyale. Une pression trop systématique sur les assurés pour les orienter vers les réparateurs agréés est susceptible de constituer une atteinte à la libre concurrence.
Par ailleurs, le contenu de certaines conventions d'agrément n'est pas toujours conforme à l'article L. 442-6 du code de commerce. Ainsi, un commissionnement de l'assureur fixé par un pourcentage unique ne tient pas compte de l'apport réel de clientèle au carrossier.
Au cours de la vie de l'agrément, si l'assureur et le réparateur ne tombent pas d'accord sur un nouveau tarif, soit l'agrément est résilié par l'assureur, soit l'ancien tarif continue d'être appliqué. Notons que la pratique du préavis en cas de rupture est très disparate. Enfin, quand la mise à disposition de véhicule ou tout autre service demandé au réparateur (par exemple la prise en charge du véhicule au domicile ou au travail de l'assuré) ne fait pas l'objet d'une mention sur la facture, cette pratique n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce.
Une charte pour garantir une réparation durable
Afin de remédier à ces tensions et au risque du prononcé de sanctions liées à l'application des dispositions des articles L. 442-6 et L. 441-3 du code de commerce, les syndicats représentant les réparateurs, la FFSA et le Gema pour les assureurs, sous les auspices de la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC), ont adopté une charte en mai 2008 (lire p. 26).
Dans son préambule, la charte Relation réparateur d'automobile-assureur rappelle que le choix du réparateur est libre, mais que l'assureur peut en proposer un à son assuré (article 1.3), toutes les parties ayant pour objectif de réaliser une réparation durable (article 1.4). L'assureur choisit librement de conclure une convention d'agrément avec un réparateur sur des critères préalablement établis (article 2.1), cette convention ayant pour objet de garantir une qualité du matériel et des services (article 2.2).
Toutes les prestations font l'objet d'une facturation (article 3.1). La remise ou ristourne consentie par le réparateur à l'assureur tient compte de l'importance de la relation contractuelle (article 3.2). Le réparateur et l'assureur se communiquent réciproquement les données chiffrées se rapportant à leur relation d'affaires (article 3.3).
Il est prévu que pour la révision de la convention, en cas de désaccord persistant, l'assureur désigne une personne habilitée pour réexaminer la demande d'augmentation formulée par le réparateur (article 3.5). En cas de non-renouvellement de l'agrément, un préavis est dû, qui tient compte de la durée et de l'importance de la relation (article 4.1).
Les représentants des professions peuvent faire évoluer la charte au fil du temps et ont prévu de se rencontrer régulièrement pour faire le point sur son application.
Des engagements entre experts et réparateurs
Dans le même esprit, un accord de relations professionnelles entre les experts d'un acteur majeur du domaine, BCA expertise, et les syndicats représentant les réparateurs a été conclu le 10 mars 2010. Il porte sur le processus de réalisation des expertises et d'échange d'informations entre le réparateur et l'expert. Outre la clause de révision de l'accord (engagement n° 8), similaire à la charte évoquée plus haut, on observera une avancée intéressante grâce à la création d'une procédure de conciliation entre réparateur et expert (engagement n° 7).
Sur le fond, le caractère contradictoire de l'expertise est mis en avant (engagement n° 1) et l'expertise à distance est aménagée (engagement n° 2). Concernant les prix, l'engagement n° 4 mentionne que la facturation s'établit selon les tarifs du réparateur, sauf « accord particulier ».
Ce texte vise à maintenir la liberté de détermination du prix par le prestataire. Toutefois, quand ce dernier intervient dans le cadre d'un agrément conclu avec l'assureur, le prix sera déterminé en fonction de cet agrément, et l'expert missionné par le même assureur pourra le contrôler. Les questions soulevées par l'agrément restent donc entières. Le non-respect des chartes et ou d'un engagement professionnel ne pourra que susciter le contentieux.
Les fondements d'un éventuel contentieux
Les engagements professionnels présentent le mérite de fixer les bonnes pratiques du secteur. Ils obligent les acteurs à échanger sur les difficultés rencontrées dans leurs relations et à mettre en avant les aspects positifs de leur partenariat. Toutefois, la pression constante sur les coûts, notamment afin de dégager des profits, d'assurer la pérennité de l'entreprise et de rémunérer ses actionnaires, conduit à ce que ces engagements professionnels ne soient pas toujours respectés.
On observera que la violation de ces engagements, qui ne sont pas directement contraignants sur le plan juridique pour les professionnels, ne reste pas pour autant sans conséquences. C'est ainsi que la Cour de cassation a condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une banque au profit de l'un de ses clients pour ne pas avoir respecté l'obligation de couverture (7), laquelle constituait une règle de nature déontologique adoptée par la profession et qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'avait instaurée. De la même manière, au soutien de toute demande d'un réparateur qui demanderait indemnisation pour une rupture de sa relation avec l'assureur qui l'avait agréé, il peut donc être invoqué la charte dont la violation constitue une faute contractuelle (si le contrat est en cours ou se termine) ou délictuelle.
En outre, et surtout, il a été développé, à l'article L. 442-6 du code de commerce, des dispositions relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies et aux clauses abusives entre professionnels. On observera que depuis le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, ce sont des juridictions spécialisées qui sont compétentes pour ces questions et que la juridiction d'appel est la cour d'appel de Paris (8).
Rupture d'une relation établie
Les actions en rupture d'une relation contractuelle établie se sont développées sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce (9). Dès lors qu'une relation commerciale s'est nouée entre deux entités, la rupture de cette dernière sans préavis suffisant entraîne une réparation sur le fondement d'une responsabilité délictuelle (10). Cela signifie que les clauses du contrat qui encadrent le montant des sommes dues et la durée de ce préavis sont écartées, quand bien même il s'agirait d'un contrat type homologué par le pouvoir réglementaire (11).
Toute fin de relation commerciale n'entraîne pas pour autant une indemnisation. Il faut que la rupture soit brutale (12). Évidemment, la faute du demandeur constitue une cause légitime de rupture sans indemnisation (13). Cela signifie que le respect d'un préavis raisonnable, au regard de la durée et de l'importance de la relation entre les deux parties, empêche l'octroi d'une indemnisation au titre de l'article L. 442-6, 5°, du code de commerce.
Ces dispositions ont été appliquées à une affaire opposant un réparateur à deux mutuelles d'assurances qui avaient résilié le contrat d'agrément (14). Le réparateur soutenait que l'expert avait commis des fautes qui avaient conduit à cette résiliation. La Cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel, qui déboutait le demandeur au motif que les dispositions du code de commerce sur la rupture de relations commerciales établies ne pouvaient pas s'appliquer à des sociétés d'assurances mutuelles.
Au contraire, la Cour de cassation a estimé que « le régime juridique des sociétés d'assurances mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, dès lors qu'elles procèdent à une activité de services » (15). Les dispositions sur la rupture brutale de relations commerciales ont donc vocation à s'appliquer à l'égard de tout assureur, dès lors que la sortie du contrat se réalise sans préavis ou avec un préavis insuffisant.
Par ailleurs, les réparateurs disposent désormais, comme tous les professionnels, d'un moyen de contester certaines clauses des contrats d'agrément, en démontrant leur caractère abusif. En effet, l'article L. 442-6 I, 2°, du code de commerce dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au Répertoire des métiers [...] de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Le sort des clauses abusives
Le Conseil constitutionnel a eu à connaître de la conformité à la Constitution de ce texte, grâce à une saisine dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (16). Le juge constitutionnel a décidé que ce texte est conforme à la Constitution, car les sanctions qu'il prévoit ne portent pas atteinte au principe de la légalité des peines. En effet, le Conseil constitutionnel a considéré que la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties était suffisamment claire et précise, et qu'elle permettait au juge de se prononcer d'une manière qui ne peut pas être qualifiée d'arbitraire, dans la mesure où elle figure à l'article L. 132-1 du code de la consommation, reprenant les termes de l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, son contenu étant déjà précisé par la jurisprudence. En outre, la juridiction saisie peut consulter la Commission d'examen des pratiques commerciales, composée des représentants des secteurs économiques intéressés (17).
Cette décision permet de comprendre que le caractère abusif d'une clause dans un contrat entre professionnels sera apprécié de la même façon qu'en droit de la consommation. Le déséquilibre va ainsi être caractérisé quand une clause prévoit un avantage pour l'une des parties sans aucune contrepartie dans le contrat. Cette approche a été adoptée dans un jugement du tribunal de commerce de Lille (18). On observera que l'action en suppression des clauses dans tous les contrats du professionnel concerné peut être intentée par le ministre de l'Économie (19). La suppression de clauses peut également advenir dans un contrat déterminé à l'occasion d'un contentieux entre deux professionnels (20).
En conclusion, on constate que la voie des accords entre professionnels représente une méthode intéressante pour réduire les tensions dans un secteur professionnel, en rétablissant le dialogue et en dégageant les obligations essentielles.
Toutefois, le maintien d'une pression forte sur l'un des acteurs par un autre (lui-même soumis à des contraintes économiques) conduit inéluctablement à l'application de dispositions légales plus dures. Les dispositions sur la rupture brutale de relations commerciales établies et sur les clauses abusives entre professionnels offrent de nouveaux fondements juridiques aux opérateurs déçus. Cela ne préjuge pas de la possibilité pour les autorités de la concurrence de sanctionner toute pratique qui porte atteinte à la fluidité du marché.
1. L'auteur de ces lignes avait été désigné comme rapporteur par la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC). Cette dernière a rendu un avis (n° 08-02) « relatif aux pratiques suivies dans les relations commerciales entre assureurs et carrossiers réparateurs », accompagné d'une charte sur la relation réparateur d'automobile-assureur adoptée par les organismes représentatifs de ces professions (lire page suivante).
2. Lionel Namin, « L'expertise automobile, Aspects juridiques et pratiques de la profession », 3e éd., L'Argus Éditions, 2009, p. 113.
3. C. route, art. L. 326-6 ; cf. Lionel Namin, op. cit., p. 65 et s.
4. Rapport d'information du Comité économique et social européen sur « La réparation automobile en cas de collision : comment garantie la liberté de choix et la sécurité du consommateur », par W. Robyns de Schneidauer, 6 septembre 2010, INT/501 - CESE 395/2010 fin, EN-LL/cc/gl.
5. Ou encore la pratique de l'expertise à distance (envoi de photos à l'expert par logiciel et Internet).
6. Lire rapport du Comité économique et social européen, ibid.
7. Com., 26 février 2008, n° 07-10.761, publ. au Bull.
8. C. comm., art. D. 442-3 et D. 442-4.
9. C. comm. art. L. 442-6 :
« I. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers [...]
5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »
10. Com., 18 janvier 2011, n° 10-11.885, publ. au Bull.
11. Com., 21 septembre 2010, n° 09-15.716.
12. Com., 9 mars 2010, n° 08-21.055.
13. Com., 18 janvier 2011, n° 10-11.611.
14. Com., 14 septembre 2010, n° 09-14.322, publ. au Bull.
15. Ibid.
16. Décision n° 2010-85, 13 janvier 2011, Darty et fils, JO 14 janvier 2011, p. 813.
17. C. comm., art. L. 442-6, III, al. 6.
18. Tribunal de commerce de Lille, 6 janvier 2010, « Contrats, conc., consomm. » 2010, n° 3, p. 21, note N. Mathey ; « Revue des contrats » 2010, p. 928, note M. Behar-Touchais.
19. C. comm., art. L. 442-6 III : « L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'Économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. »
20. Ibid.
Luc Grynbaum (1), professeur à l'université Paris-Descartes, directeur du master 2 Santé, prévoyance et protection sociale, doyen honoraire de la faculté de droit de La Rochelle
|
Contiunuer plus des renseignements avec Google : Click here :: Tous les Magouilles et Arnaques en France ::
Cliquez ici
|
|
|
!! Réparation automobile : vigilance face aux arnaques !! : France - 2 Television Programme)
A REVOIR : Présenté par - David Pujadas - Diffusé le 10/09/2014 - Durée : 00h40
Vidéo : CLICK HERE
|
|
Réparation automobile : vigilance face aux arnaques (France-2 Television Programme) - Présenté par David Pujadas) - 10.09.2014
En France, notre enquête maintenant sur les pièges de l'entretien et la réparation automobile. Les Français, on le sait, sont Ce soir, on va s'intéresser non pas aux concessionnaires ou aux petits garages indépendants mais aux centres autos, ces marques, ces chaînes désormais très connues qui proposent des services rapides et sans rendez-vous. Poussent-ils à la consommation ? Y a-t-il des abus. Promo imbattables, sur les pneus, les freins ou les vidanges, les centres auto affichent 30% moins cher. Ces grandes enseignes implantées dans toutes les villes sont-elles aussi fiables qu'elles le prétendent ? Nous avons testé ces garages, rencontré d'anciens employés. Notre enquête commence au parking de France 2. La voiture est une Laguna, 77 000 km, roule depuis 5 ans, toujours entrenue selon les instructions du constructeur. Pour connaître son état, rendez-vous au contrôle technique. L'examen dure 30 minutes sur une centaine de points. Les plaquettes ne sont pas usées, le disque est un épuisé. Vous en avez encore pour 20 000 km. La batterie de tests est terminée, c'est un sans faute. Malgré la carosserie abîmée par endroits, notre véhicule est en parfait état. Nous pouvons prendre la route en toute sécurité. Nous allons prendre l'avis de plusieurs centres auto. Nous commençons le test dans ce garage de la banlieue parisienne. Bonjour, je voulais faire une révision sur une voiture que j'ai achetée. Les mécaniciens se mettent à trois. Ils inspectent tous les organes de sécurité, sous nos yeux. Combien de temps pour les plaquettes et le disque. Premier test, même constat qu'au contrôle technique. Nous faisons quelques kilomètres, autre enseigne, même scénario. Le mécanicien nous invite à quitter le garage. Une heure plus tard, les clés sont accompagnées d'un devis étrange. Des algues dans le moteur, l'argument laisse perplexe. Le technicien insiste sur des pièces plus onéreuses. Le système de frein était jugé sans danger au contrôle technique. Nous repartons avec un devis de 369 euros. Dans ce 3e garage, le devis est à plus de 600 euros. Le disque et les plaquettes avant sont à changer au plus vite. Et celles de l'arrière à prévoir aussi. Cela ne passerait pas. L'argumentaire est rodé: notre sécurité serait en jeu. Pour assurer la vente, le mécanicien n'hésite pas à nous faire pur. Je n'ai pas droit de vous laiser partir. Je peux bloquer la voiture. Bientôt, il n'y a plus de freins à l'avant. Souvenez-vous du contrôle technique officiel. Notre voiture test ne présentait aucun danger pendant encore 20 000 km. Les 3 centres ont présenté 3 diagnostics différents. Les employés détiennent la réponse. Nous avons rencontré ce mécanicien qui a travaillé 7 ans dans un centre auto. Il est aujourd'hui à son compte. Vous voulez 1 700 ou 1 800 euros par mois ? Vous vendez des freins qui ne sont pas à remplacer. On s'en fout, faites de l'argent. Pour vendre, les mécaniciens ont leurs méthodes. J'ai dû changer des disques qui n'avaient que 16 000 km. Si quelqu'un demande la vidange par urgence, il va prendre cher. Il n'a plus le choix, il part en vacances avec sa voiture. Certains iraient jusqu'à simuler les pannes. Exemple pour un frein arrière, il y a toujours un peu de liquide. On le badigeonne à l'intérieur et on le salit. On demande à monsieur de repasser, c'est 250 euros dans la poche. Les mécaniciens auraient un intérêt personnel à vendre des pièces inutiles. Pour le vérifier, nous nous sommes procurés cette fiche de paie. Chaque vente rapporte au mécanicien. Le salaire brut passe de 1.450 à plus de 1.700 euros. Les centres auto n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. Ils assurent que ces pratiques de rénumération auraient changé. Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut connaître son garagiste, exiger les anciennes pièces a priori défectueuses et faire établir plusieurs devis. |
|
|
Cliquez ici + Click Here
Si un magouille garagiste a mal effectué les réparations d'un véhicule et met ainsi son client en danger, il peut être poursuivi sur le plan pénal pour mise en danger de la vie d'autrui, blessure ou homicide involontaire. !! Pour votre propre sécurité, Partager ces toutes les informations avec tous les utilisateur d'véhicules !! : Entrée Cliquez ici
|
|
|
CONTRE TOUTES SORTES DE ARNAQUES ET MAGOUILLES
AGAINST ALL KINDS OF SCAMS AND TRICKS IN FRANCE
|
|
|
|
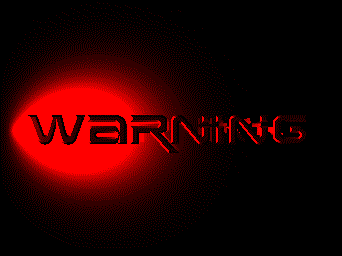














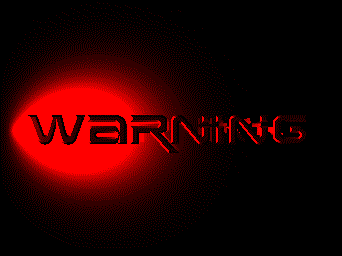
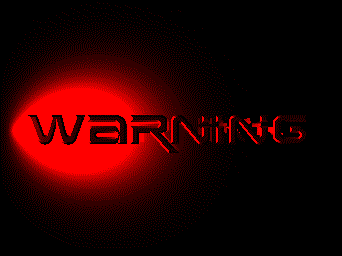





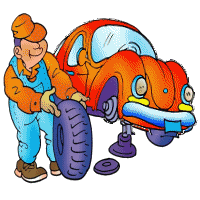


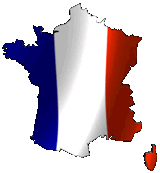

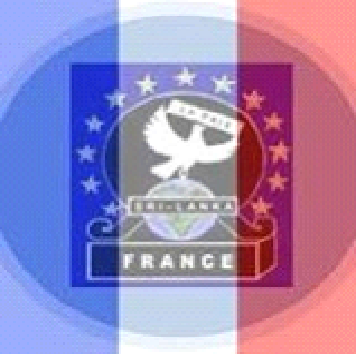






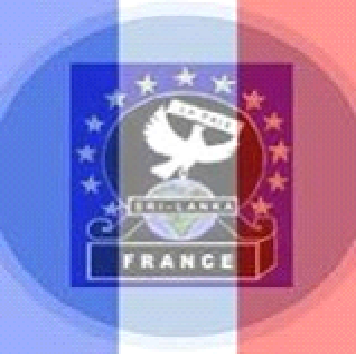




















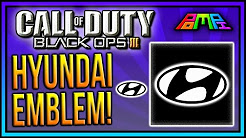





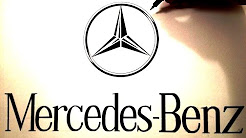


























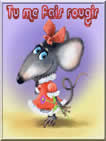





















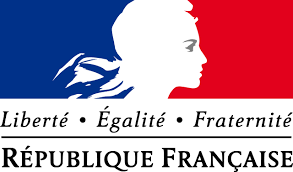

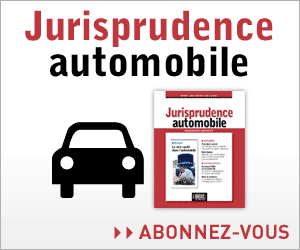 Cliquez sur le Images
Cliquez sur le Images




